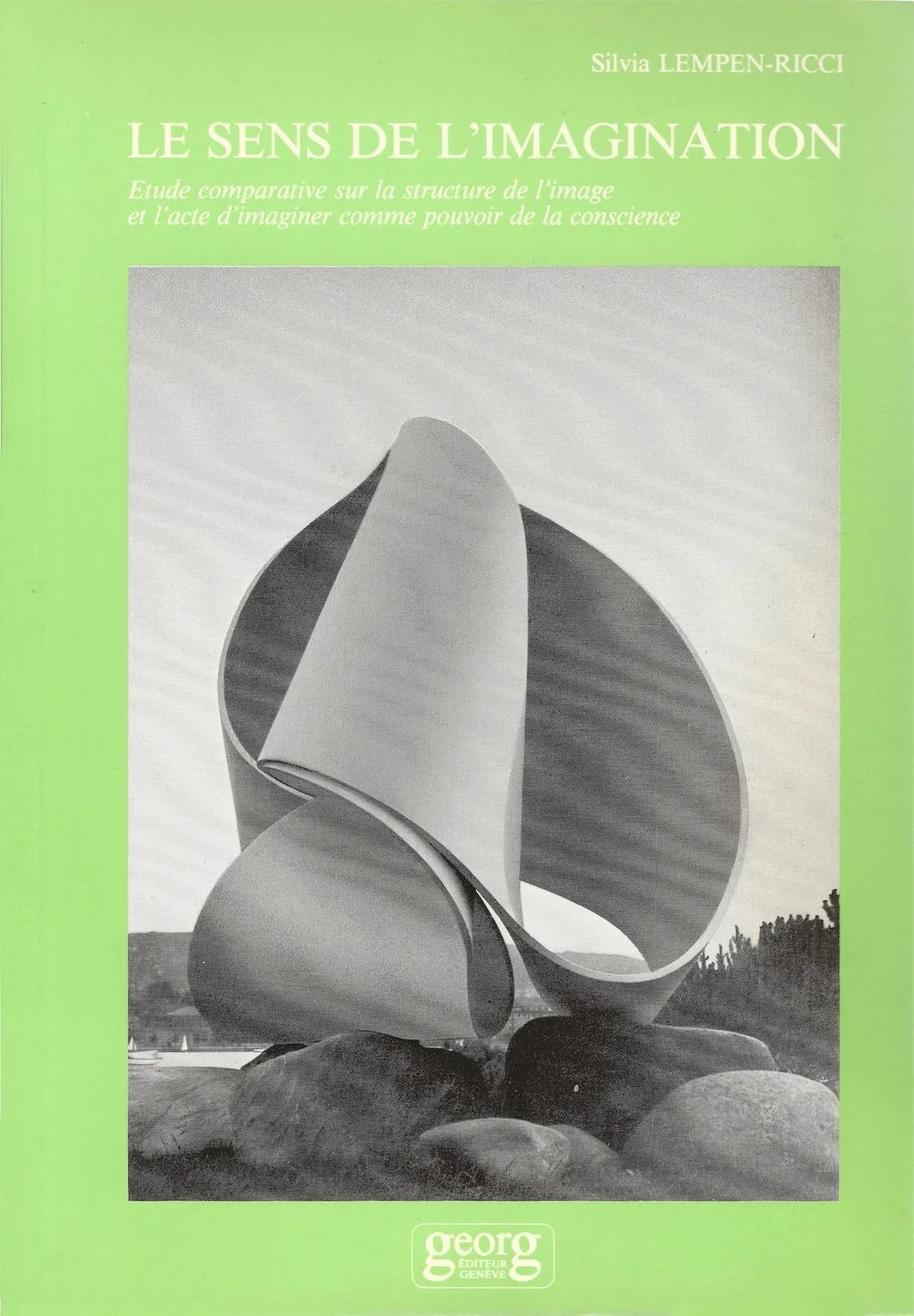Le sens de l’imagination
Étude comparative sur la structure de l’image et l’acte d’imaginer comme pouvoir de la conscience.
Librairie de l’Université Georg et Cie, 1985, Genève.
Pendant sept ans, à la maison avec mes enfants en bas âge, j’ai écrit une thèse de doctorat sur l’imagination, que j’ai définie comme la faculté de la joie, parce qu’elle a le pouvoir d’augmenter le réel et d’enrichir le sens de notre finitude. C’est le seul ouvrage philosophique que j’ai été capable d’écrire, mais la finitude et l’infini, les énigmes de la métaphysique ne cesseront jamais de me passionner.
« Une intéressante étude historico-systématique de la question philosophique de l’imagination. La question s’entend comme étant celle du sens de l’imagination en tant que pouvoir humain irréductible aux images qui le manifestent mais dont l’approche philosophique n’est possible que par le biais d’une interrogation sur l’essence de l’image. La part la plus importante du travail consiste en sa «partie historique», où un choix de théories philosophiques de l’imagination sont examinées de façon critique. Ces théories ont été retenues, au dire de l’auteur, en fonction de l’apport fourni par leur lecture à la conception originale esquissée en fin de parcours, mais annoncée et construite pas à pas tout au long de l’étude critique. Les théories envisagées — outre qu’elles permettent de faire ressortir les thèmes fondamentaux que devra retenir la partie systématique de l’ouvrage — contribuent à mettre à jour la connexion nécessaire des interrogations sur l’essence de l’image (sa structure et son mode de production) et le sens de l’acte d’imaginer, cette connexion nécessaire devant être conçue, dans les termes de l’auteur, «comme une synthèse originaire impliquant une détermination réciproque».
L’étude historique et critique met en lumière deux écueils dans l’étude philosophique de l’imagination. L’écueil psychologique, d’abord, mis en évidence sur les exemples d’Aristote et de Freud et la psychanalyse, qui manquent la dimension essentielle de l’imagination, soit faute d’interroger suffisamment la structure et le mode de production de l’image (Aristote), soit (Freud et la psychanalyse) pour se braquer sur une fonction de l’image, en l’occurrence sa signification affective. L’écueil cognitif, ensuite, sur lequel butent les théories qui n’envisagent l’imagination qu’en égard à une autre de ses fonctions: la fonction cognitive, ce que font, selon l’auteur et sous diverses modalités, Kant, Husserl, Sartre…
Les études historiques sont fort bien menées, rigoureuses et documentées. L’auteur en dégage, positivement et par-delà les critiques, les deux thèmes fondamentaux qu’il lui faudra reprendre de façon originale dans la courte seconde partie du livre: la temporalité et l’affectivité (le désir). L’imagination est comprise, sous ces deux thèmes, comme la démarche cruciale qui permet à l’homme «de se réapproprier le monde dans sa mondanéité», ainsi que l’indique la page de présentation de l’ouvrage. »
Danielle Lories, Revue Philosophique de Louvain, 1987